Centre de Recherche Indépendant de Yoga Adapté (KRIYA)
Institut de Thérapie holistique, YOGA, Yogathérapie
Ecole de Yoga - Yogathérapie
Pour votre bien-être

|
|
INSTITUT LEININGER
Centre de Recherche Indépendant de Yoga Adapté (KRIYA) Institut de Thérapie holistique, YOGA, Yogathérapie Ecole de Yoga - Yogathérapie Pour votre bien-être |
 |
- Un bon mental, une bonne philosophie de vie, un corps souple et fort pour mieux vivre sa vie -
44 ans de professionnalisme dans l'enseignement du Yoga
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Si mes débuts de professeurs de Yoga ont eu lieu en 1977, (voir Qui suis-je ? ) c'est en Janvier 1979 que j'ai pris officiellement le statut et la fonction d'enseignant professionnel de Yoga (voir Prochain rendez-vous), avec tout ce que cette expression implique en termes d'engagements et de garanties prises afin de répondre à votre désir et besoin de bien-être, d'épanouissement, d'évolution par la pratique du Yoga et des techniques psychocorporelles (voir aussi Cours de Yoga individuel). Il m'arrive parfois ...
|
... de parler de professionnalisme dans l’enseignement du Yoga
comme je l’ai mentionné ... Ceci n’a pas toujours été clair pour les uns qui n’entendaient pas cette option et les autres qui pensaient que peut-être et même sûrement, je tentais par là-même, de détrôner leur gourou préféré. J’ai simplement décidé il y a longtemps, de me donner les moyens nécessaires à une transmission correcte aussi complète que possible de la tradition du Yoga et respectueuse de notre culture qu’il n’est ni souhaitable ni possible de nier : ˝… imiter l’Orient est une méprise tragique˝, écrivait C.G. Jung qui insistait sur le fait que, sur la voie du Yoga, l’Occidental ne doit pas ˝… renoncer à son entendement occidental˝. |
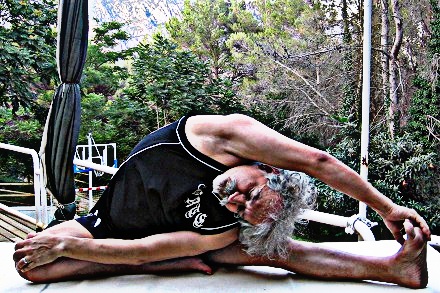 |
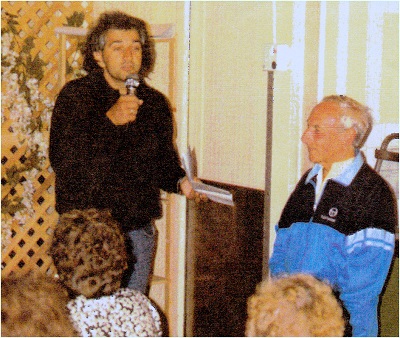 Auprès d'André Van Lysebeth, 1993 |
Partant de là, vous l’aurez deviné et de toute
façon, vous commencez à me connaître, c’est depuis longtemps que j’aime bien
appeler un chat un chat, et que je ne me laisse plus embringuer dans des
tentatives de récupération quelles qu’elles soient, visant à me faire taire ou à
déformer mes intentions ou mes propos par des élus associatifs, politiques ou
fédéraux toujours en manque d’arguments fondés sur des faits précis. Une impérative nécessité Donc, si vous n’y voyez pas d’inconvénient, dans cet exposé de 35 ans de professionnalisme, je continuerai à appeler un chat, un chat, sachant que mon intention est que vous sachiez mieux encore, qui je suis et par là-même, les raisons de votre choix de pratiquer le Yoga traditionnel sous ma direction. |
J’ai donc décidé
d’en faire mon métier en 1978, ce qui s’est concrétisé en janvier 1979, lorsque
je me suis inscrit en indépendant, il y a précisément 35 ans et quelques
semaines.
Les premières fois
Les tout premiers stages de Yoga datent de cette même année, à Fronsac et au
CREPS de Toulouse.
Le premier Mémorandum, support de cours qui vous accompagne
dans vos stages de Yoga, est apparu en 1981 : nous en sommes actuellement à plus
de 160 qui sont parus. Ce choix de la voie du
professionnalisme dans l'enseignement
du Yoga m’amena au respect de la déontologie et à la remise en cause de
certaines pratiques comme ˝Apprendre à
respirer˝, la posture sur la tête, le rapport au ˝maître˝, le travail sur la
sangle abdominale et toute la dimension pédagogique et d’observation liée aux
pratiques, la notion de tradition, la nécessité d’insister sur le temps
d’expiration dans la respiration … et aussi tout ce qui pouvait se montrer
anti-pédagogique. Par contre, le respect de l'autre, de son souffle, de son
rythme, la compréhension de notre fonctionnement m’ont guidé et sont encore mes
moteurs aujourd’hui, tant ces dimensions sont inséparables de la fonction
d’enseigner le Yoga et sa tradition.
˝Considérations sur la respiration˝
Dans la continuité de ce cheminement et concernant la respiration, j’ai
travaillé à un texte particulier, achevé en 1983,
dont le titre reste toujours : ˝Considérations
sur la respiration˝.
Je dois vous avouer que j’en suis relativement fier, car encore aujourd’hui, il
n’y a rien à y enlever et très peu de choses à y ajouter. Tout ce qu’il faut
savoir d’essentiel sur la fonction respiratoire et le souffle dans l’optique
d’une approche concrète des techniques respiratoires du Yoga, s’y trouve. Il
suffit de le mettre en pratique … Tous mes cours, stages et écrits sur la
fonction respiratoire et le souffle dans la pratique du Yoga, sont sous-tendus
par ce contenu incontournable et incontestable à la fois.
La conception ainsi posée s’appuie sur une vraie réflexion liée à l’observation
et l’expérimentation (selon le tantra) obéissant aux règles régissant la
démarche scientifique et l’épistémologie, liées à la raison. Les lenteurs et
troubles repérés par Gaston Bachelard
dans l'acte de connaître, sont autant de causes de stagnation, voire de
régression et désorientent vers des préjugés par rapport auxquels Masson-Oursel
met en garde dans son ouvrage sur le Yoga (˝Le
Yoga˝, Collection Que sais-je ?)
afin de faire éviter une mauvaise voie à qui veut suivre la démarche indienne.
Tout comme Descartes invitait à ˝se
défaire de toutes ses opinions …˝, Bachelard propose de débusquer ces
suppositions que l’on prend pour vérités :
|
Un lieu de travail particulier à New Delhi |
La perception et la compréhension du sujet ˝Yoga˝ ainsi bien posées, présentent
une grande différence avec ce que l’on entend dire parfois qui démontre que ce
phénomène naturel est intellectualisé à outrance sans être réellement bien
interprété, bien abordé, bien conçu et donc, bien intégré. Cet état de fait se
complique à cause du caractère ˝tamasique˝ de lourdeur et d’inertie
caractérisant la ˝doxa˝
qui réunit mollement les
opinions incomplètes, les idées confuses suivies par tous, les préjugés jamais
remis en question, les présuppositions admises par tous ceux qui n’ont pas osé
vérifier ce qu’ils recevaient ou ont décidé de retirer des avantages de la
crédulité ambiante.
Nécessité de l’expérience
La conséquence est que le Yoga ne peut être compris dans son essence et dans sa
manifestation, puisqu’il est reproduit intellectuellement alors qu’il faut s’en
faire une réelle expérience assurant ainsi un réel vécu dans la
spontanéité de la fonction, non par son seul cortex, mais par son propre corps,
ses propres sensations, ses propres perceptions. C’est un des messages du
Tantra.
On ne saurait plaquer une description sur du vivant pour que celui-ci lui
obéisse, mais on part du vivant pour en tirer des principes sur lesquels on peut
alors poser ses pratiques de façon raisonnable et utile car, comme disait le
philosophe Francis Bacon
(1561-1626) :
˝On ne commande à la nature qu’en lui obéissant˝.
C’est pourquoi nous devons considérer deux choses. La première, dans ce domaine
délicat du souffle est que la respiration évoquée ci-dessus, est avant tout un
acte articulaire avant d’être musculaire et volontaire.
A propos du corps
En second, nous devons admettre une évidence : on ne peut mettre en place ce que
les Hindous font avec facilité si on n’a pas les prérequis nécessaires.
Je dois mentionner dans cette démarche de professionnalisme, mon vécu corporel
passant par des pratiques très intenses de Yoga avec des séances quotidiennes de
plusieurs heures ou encore le maintien de postures de longue durée pouvant aller
jusqu’à près d’une heure dans les années 80 et aussi d’autres expériences
encore.
Ainsi, ayant entendu dire que le Yoga permettait au dos de résister à tout, j’ai
commencé en 1980, à pratiquer l’haltérophilie en même temps que la danse
classique. Je ne suis resté dans cette dernière discipline que durant six mois,
tandis que la pratique de l’haltérophilie (à ne pas confondre avec la
musculation !) s’est poursuivie : elle m’a beaucoup apporté dans la
compréhension de certains gestes corporels présents dans le Yoga traditionnel.
|
|
|
Pythagore
Fontenelle |
La rédaction du mémoire ˝L’apprenti-yogi
ou l’anti-sage˝ de fin de formation de Psychopédagogie (1983-1984), montre
bien ce refus de toute soumission, déjà présent à l’époque et qui m’anime encore
aujourd’hui. Apprécié et redouté à la fois pour la justesse et le caractère
argumenté de mes avis, je fonctionne selon ce principe du sage indien Shivananda
(1887-1963) :
˝Que vos mots soient doux et votre
argumentation solide˝
De Shivananda à Pierre Bayle
|
Shivananda |
Engagement du Yoga
Enseigner le Yoga signifie donc, agir en ce monde pour son amélioration :
amélioration de la condition physique, mentale de nos contemporains en
souffrance, mais aussi leur guidance vers une prise de conscience bien réelle et
bien pleine de leur propre capacité à agir sur eux-mêmes et sur leur propre vie.
Cet engagement dans le monde doit s’effectuer dans l’esprit du Karma-Yoga, le
Yoga de l’action désintéressée car les quatre grands Yoga-s sont à pratiquer
ensemble.
″Il n’est pas nécessaire d’espérer pour
entreprendre … disait Guillaume le Taciturne, …
ni de réussir pour persévérer″.
Pour mener convenablement cette action, il nous faut cultiver force et
souplesse, puissance et sensibilité, douceur et fermeté, comme nous y invitent
Ha et Tha qui sont Lune et Soleil, masculin et féminin présents dans le
personnage Ardhanarishvara.
Dans cette démarche, la transmission du Yoga doit être respectueuse de notre
propre culture, celle issue de nos valeurs occidentales dont celles
républicaines ou encore celles défendues par de grands penseurs français qui ont
fondé notre mode de pensée en accord avec la dignité humaine, la liberté, la
raison.
|
Ardhanarishvara
|
″Mieux va
François Rabelais
Alain, 1868-1951
ut pour chacun sa propre loi
d’action, même imparfaite, que la loi d’autrui, même bien appliquée″


Vous l’avez reconnue : elle est au bas de la page 3 de la revue : son importance
est grande puisque dans le texte sacré où elle est écrite, on la trouve deux
fois avec une formulation quasi identique (Bhagavad
Gîtâ III, 35 et XVIII, 47).
Le choix de la pensée libre
Rabelais, Montaigne, ne disent pas autrement lorsqu’ils évoquent le lien entre
l’enseignant et l’élève. En fait, le Yoga est une voie d’autonomie qui porte un
nom sanskrit : ″Vairagya″ (trad :
lâcher-prise, détachement au sens de non-attachement au monde sensible,
renoncement) qui est une des composantes de la pratique avec l’assiduité.
Le gourouisme, le suivisme, le conformisme et le tailisme sont à éviter sur
cette voie où chacun doit trouver sa voie en s’inspirant des grandes
lignes tracées il y a des milliers d’années par les yogis de l’Inde.
Le philosophe Alain dont j’ai entendu dire il y a environ un an que certains le
considèrent comme l’un des plus grands philosophes français, écrivait :
″Penser c’est dire non !″
Extrêmement critique vis-à-vis de ce que l’on pourrait nommer l’endoctrinement
et sa facilitatrice non-compréhension des choses, il disait qu’était
préférable :
˝…
la liberté des autres que l'obéissance des autres˝.
J’ignore si Alain pratiquait le Yoga, peu connu en France à l’époque où il
écrivait, mais nous devons reconnaître que c’est la liberté et l’autonomie que
propose le Yoga traditionnel, et non l’asservissement à une technique, une
méthode, une voie.
Pour resituer le Yoga dans ce qu’il est véritablement, nous devons considérer
que la tradition qui le sous-tend comporte le refus de vivre comme le commun des
mortels, de céder aux élémentaires inclinations de notre nature, de se laisser
penser et de céder le pas au mental Alain n’est pas loin :
˝Réfléchir, c'est nier ce que l'on croit. Qui croit ne
sait même plus ce qu'il croit. Qui se contente de sa pensée ne pense plus rien.
˝Yoga Chittavritti Nirodha˝
Cette stance du texte classique indique qu’il faut
décider de l’arrêt des mouvements désordonnés du corps, le refus de
l’irrégularité respiratoire, la cessation décidée du gaspillage d'énergie,
l’arrêt de l'accumulation du karma, la prise de conscience des communications
verbales inutiles afin de les stopper, la connaissance des automatismes pour les
contrôler, en résumé, la prise de conscience de l’existence de l’expression
naturelle qu’il faut apprendre à contrôler.
L’adoption de l’immobilité du corps, du souffle, du mental vient s'ajouter aux
nombreuses autres attitudes qui jalonnent la pratique : se libérer du
conditionnement, maîtriser les passions, se dégager des asservissements, établir
le calme et chercher à contrôler son existence. Ainsi, le contrôle du corps, de
la respiration, du mental, constitue la voie permettant d’accéder au but indiqué
par le deuxième Sutra du Yoga de Patanjali cité plus haut. En effet, ces
quelques mots sanskrits assemblés rappellent l’essentiel du Yoga traditionnel :
l’arrêt des agitations du mental, ce à quoi servent les divers contrôles nommés
ci-dessus et auxquels se livre le yogi. Aussi, pas de discours hermétique,
inaccessible, nébuleux ou abusif : le yogi occidental a besoin de concret et de
pragmatique, d’autant que les discours fumeux n’ont jamais fait avancer ni les
gens, ni les choses.
Conscience et ˝Illusion˝
Et puis, comment peut-on imaginer que pour dépasser l’Illusion, laquelle est,
pour l’Inde, la première source de souffrance humaine, on doive faire passer les
pratiquants dont on a la responsabilité, par une illusion de plus, celle du
décorum, de l’apparat, du factice, des mots ronflants et des senteurs d’Orient
accompagnées de l’artifice de discours ésotériques incompris par ceux qui les
émettent ?
|
Lily Ehrenfried |
Yoga et culture
C’est pourquoi, en complément, je me suis intéressé aussi bien aux philosophies
d’Occident qu’aux sciences, ce qui me permet d’évoquer en toute simplicité, la
philosophie comparée ou encore l’anatomie comparée (Cf les visites du Muséum
avec l’école de Yoga).
|
Une rencontre unique pour
comprendre qui nous sommes |
Je ne peux bien sûr, omettre d’autres noms qui viennent s’ajouter à ceux
déjà cités : Carl Rogers, Carl Gustav Jung, Roberto Assagioli, Abraham
Maslow, Georg Groddeck, Sigmund Freud et d’autres encore, ont leur place.
En effet, dans ce même esprit, les enseignements de la psychologie moderne et
des différents courants liés à l’évolution des découvertes sur le psychisme
humain depuis William James, permettent de mieux comprendre la pensée indienne
dans son aspect mental, et ce d’autant que corps et psyché ne sauraient être
opposés.
Cet apport voit aussi son importance en ce qu’il a amené des questionnements
aussi poussés que ce qu’on trouve en Orient, sur la présence d’un corps
psychique en chaque être et sur l’avant vie et aussi l’après-vie.
Chercher encore …
On comprend, à ce point de mon discours, combien peuvent être considérés comme
fondamentales, la compréhension du fonctionnement de l’être humain et en
suivant, l’épistémologie, le triangle didactique déjà évoqué, la
psychopédagogie, ces moyens devant conserver un lien étroit avec des valeurs
humanistes, celles qui placent l’être humain au centre des préoccupations
essentielles et cessent de le soumettre à des idéologies ou dictats quels qu’ils
soient. Sans cela, aucune démarche spirituelle ou initiatique comme le Yoga qui
permet de passer à une vie nouvelle, ne saurait avoir de sens.
|
Savoir
Enseignant
Elèv L’approche, la transmission et
l’apprentissage du Yoga s’inscrivent inévitablement tous trois dans
le triangle pédagogique.
Aux côtés d’André Van Lysebeth.
|
Les prérequis fondamentaux
Le Yoga vécu comme il l’est en Inde, s’adresse à une élite à laquelle notre mode
de vie ne nous permet pas d’accéder. C’est la raison pour laquelle il importe de
commencer par le commencement, de jauger les potentialités de chacun avant de le
lancer sur une voie à suivre avec prudence comme toute voie efficace. La
nécessité de considérer ce que chacun peut et veut faire, ainsi que
l’acquisition des prérequis, sont indispensables.
C’est aussi la raison pour laquelle au plan technique, chaque session qui vous
est proposée est faite de prudence, de précision et d’un travail personnalisé et
adapté avec une approche sous forme d’atelier où chacun peut s’approprier
véritablement les pratiques enseignées en passant de la découverte à l’acquis
car on ne peut courir sans savoir marcher.
|
Ardhabaddhapadmapashchimottanâsana …
Bruguières, 1982 |
S’émerveiller du corps
C’est aussi l’occasion de lier les deux, philosophie et corps. En effet, se
rendre compte des 300.000 kilomètres de vaisseaux capillaires qui parcourent
notre corps et apportent à chaque cellule de l’organisme ce dont elle a besoin,
des 300 millions d’alvéoles qui captent l’oxygène de l’air inspiré, de
l’intelligence mécanique d’une très grande précision qui permet à nos
articulations de bouger de façon automatique tout en supportant des pressions et
des tensions énormes, ne peut être qu’une occasion supplémentaire de
s’émerveiller de ce phénomène de la vie présent en chacun de nous et à tous les
niveaux de notre être.
Sans oublier les opérations et échanges chimiques qui se font en permanence en
nous, le dynamisme mental, la capacité à se fixer sur un point précis (˝ekagrata˝),
notre énergie et son organisation, l’extraordinaire complexité de notre système
nerveux aussi bien central que végétatif, la merveilleuse organisation de nos
sens qui nous permettent de capter en ce monde, l’essentiel des informations
dont nous avons besoin, tout ceci ne peut que nous amener à cette attitude du
psychanalyste Georg Groddeck, au début du XXème siècle :
"En définitive, pour nous mortels, il n'est qu'une attitude : l'étonnement".
Partant de là, tout peut s’expliquer et s’enseigner selon une compréhension
nécessaire et une pédagogie adaptée dans l’idée du triangle pédagogique déjà
évoqué (Cf. supra page 25 et Drish n°114).
D’où la mise en place, depuis 1979, de plus de 150 stages d’un jour à une
semaine, auxquels s’ajoutent une centaine d’interventions en co-animation dans
les départements du Grand Sud, et aussi
à Paris, dans diverses associations ou écoles, la création dès 1986 de la
bibliothèque spécialisée qui vous est ouverte et la naissance de ma revue de
Yoga en 1988 dont le but est de faire le lien entre Orient et Occident.
Ces trois médias –stages, revue, bibliothèque- sont des moyens fondamentaux tant
il est vrai que la connaissance est une des clés de la liberté et du bonheur et
qu’elle permet d’étayer et orienter la réflexion et les expériences, ce qui
garantit les moyens de développer l’évolution de chacun sur tous les plans de
son être. Cette connaissance est utile aussi dans la nécessité de se connaître
soi-même.
|
Une petite merveille en
200.000.000 d’exemplaires |
Socrate et ˝Swadhyaya˝
La connaissance de soi (˝Swadhyaya˝,
4ème règle des ˝Niyama˝,
deuxième étape du Yoga traditionnel) fait le fondement de toute discipline et le
silence déjà évoqué, en est une clé d’accès.
Si on y regarde bien, et bien que le terme lui-même surprenne, voire effraie,
l’ascèse ne nous est pas si étrangère puisque les philosophies et courants
religieux fondant notre culture, proposent une discipline normalement mesurée
dès l’instant où l’on a décidé de ne plus se laisser impressionner par ce mot et
où on s’est rendu compte à quel point toute discipline respectueuse de l’être,
apporte de très nombreux avantages.
Si on supprime les préjugés, clichés, dictats et autres superstitions, on peut
aisément se rendre compte que nos grands penseurs ont doté notre monde
occidental d’une grande richesse (voir plus loin l’article sur Bayle).
La quasi identité entre le Shiva-Pashupati indien et le Cernunos de nos ancêtres
Celtes (voir clichés) est la démonstration qu’une pensée universelle traverse
les âges et les espaces et propose une voie d’élévation, quelle que soit sa
forme.
Cette universalité de l’ascèse permet de passer à une autre dimension et de
renaître à une autre vie, une vie réellement choisie dans l’esprit de ce que
souhaitait Pierre Bayle, de conduire sa vie en fonction de ce qui nous semble
sincèrement le plus juste. Elle passe par la triple association
Mouvement-Souffle-Conscience
spécifique au Yoga traditionnel qui aboutit au contrôle de soi (Cf. la session
de Mai 2014).
C’est encore elle qui permet de poursuivre vers les buts du Yoga qui sont de ne
plus vivre comme le commun des mortels.
Tout cela est essentiellement lié aux activités irrégulières et désordonnées du
corps, de la respiration, de l’énergie, du mental, de l’expression, lesquelles
sont, pourtant, le résultat de la manifestation naturelle de la vie.
|
Pierre Bayle (cliquer ici) |
Et le silence ?! …
L’ascèse et la connaissance de soi passant par la voie du silence, la toute
première session de silence, je l’ai animée en 1983 à St Mont, dans le Gers.
Actuellement, deux sessions de silence vous sont proposées chaque année, qui
permettent de goûter cette délicieuse phrase de Belguise :
˝Dans le silence et la solitude, on n’entend plus que l’essentiel˝.
Dans Drish 120, j’ai évoqué cette peur du silence qui n’est rien d’autre que la
peur du noir quand on est enfant ou la crainte de la solitude, laquelle est une
composante inévitable de l’existence humaine. C’est ce que me rappela de vive
voix, Jeanne Liberman dont vous avez pu faire la connaissance dans les numéros
111 et 112-113 de la revue, au début des articles
˝Papy s’entraîne tous les jours˝.
Elle s’était mise à pratiquer les Arts martiaux et le Yoga à un âge avancé et
est l’auteur du livre ˝La vieillesse, ça
n’existe pas˝ qui eut beaucoup de succès dans les années 79-80. Je la revois
encore, en 1984, me saluant sur le pas de sa porte et m’adressant ces quelques
mots si simples :
˝N’oubliez pas : chacun est seul sur sa route !˝.
Or cette appréhension par rapport à la solitude et au silence, n’est que le
reflet d’une peur plus fondamentale encore, inscrite en nous et liée à notre
condition humaine que la pratique du Yoga permet de dépasser par les aspects
symboliques, philosophiques et expérientiels, à condition que cette pratique
soit conforme à la tradition dont le Yoga est le porteur inséparable.
En résumé …
La richesse du Yoga et de sa tradition se trouve dans la confrontation de sa
propre philosophie acquise par ce que l’on peut connaître des penseurs
occidentaux et de la tradition du Yoga, à ce que l’on vit au quotidien et
surtout pas en s’enfermant à l’abri dans un refuge qui ne donne qu’une vision
partielle et fausse de la réalité.
La dimension pédagogique et psychologique, la
précision technique, l’application des sciences à l’enseignement et la pratique
du Yoga, l’étude des sagesses et philosophies d’Occident, de l’Inde et de
l’Orient, l’approche de l’humain sous toutes ses composantes, l’étude des
techniques classiques et leur adaptation aux pratiquants sont autant d'outils
permettant un vécu constructif.
La dimension pédagogique évoquée
est fondamentale : elle inclut des séances et ateliers, des échanges sur
l’approche et le vécu des techniques abordées, de leurs effets et du ressenti de
chacun.
Une attitude concrète
Cette façon d’agir comprend aussi des pratiques
adaptées et leur correction, la
découverte et le développement du sens de l’observation, la connaissance
concrète, l’étude d’exercices progressifs pour une meilleure adaptation à chaque
participant. La réflexion porte sur la technique, l’aspect concret et
pragmatique à la lumière d’apports informatifs et de mon
expérience professionnelle dans les
domaines de l’enseignement du Yoga, de la pédagogie et de l’accompagnement
psychologique.
Cette façon de procéder influe sur la façon de pratiquer et d’enseigner pour les
futurs enseignants de Yoga et aussi pour les professeurs de Yoga venant se
perfectionner à mes côtés.
C’est encore une fois la démonstration que les sciences d’Occident peuvent aider vraiment à mieux comprendre et adapter le Yoga à notre monde. En cela, je fais partie des quelques rares ˝dinosaures˝ du Yoga qui sommes restés fidèles à l’école de l’ascèse indienne dans son acception la plus complète, soucieux d’une transmission aussi large et adaptée que possible.